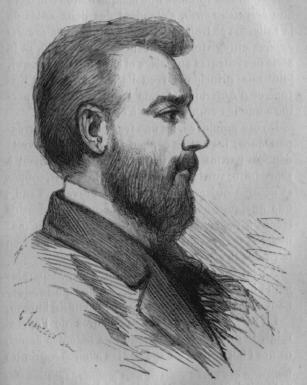
L'Historique du Téléphone
I) Dates importantes
Dans les années 1870 : Un service d'appel télégraphique est créé à New York. Les utilisateurs, à l'aide d'une manivelle, peuvent envoyer un signal au Central. Le nombre de tours indique d'ailleurs le service demandé (Pompiers, police, médecin, ...).
Le 14 février 1876 : Graham Bell dépose aux Etats-Unis une demande de brevet pour son invention : le téléphone
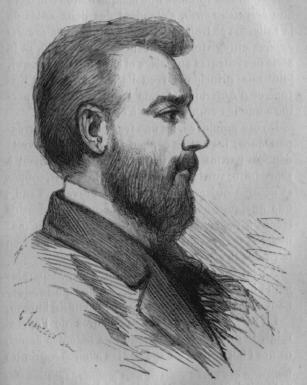
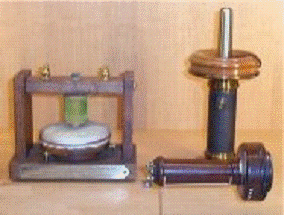
Graham Bell
Transmetteur expérimental de Bell Récepteur expérimental de Bell
Le 1er mai 1877 : La première ligne commerciale privée est mise en service, elle relie le bureau d'un homme d'affaires de Boston, Charles William, et sa maison à Somerville : c'est le début de la commercialisation du téléphone.
1877 : Dans les centraux, l'établissement des communications se fait manuellement par des opératrices appelées les "Demoiselles du téléphone".
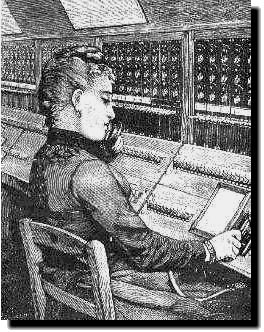

Une conversation téléphonique ! ...
1889 : un certain Almon B. Strowger, entrepreneur de pompes funèbres à Kansas City, invente le premier autocommutateur électromagnétique parce que l'opératrice du téléphone, épouse de son concurrent, dirigeait les clients éventuels vers le bureau de son mari !
1906 : L'invention de la lampe triode par l'américain Lee de Forest rend enfin possible l'amplification du signal téléphonique qui devenait trop faible au bout d'une quinzaine de kilomètres. On raccorde les centraux entre eux et on constitue un réseau national. Le premier câble français, de Paris à Strasbourg, est mis en service en 1924 puis celui de Paris Lyon, en 1925.
Jusqu'en 1950 : l'établissement des communications téléphoniques internationales est réalisé manuellement par une opératrice. Il faut attendre 1971 pour que soit ouverte la liaison complètement automatisée entre la France et les Etats-Unis.
1970 : les liaisons entre les centraux électroniques sont numérisées en adoptant le dispositif de modulation par impulsions codées (MIC).
1980 : MINITEL
1990 et + : ENREGISTREUR DE MESSAGES
TELEPHONE CELLULAIRE ET SATELLITE
II) En France
Le 25 juillet 1877 : Bell dépose un brevet en France pour protéger son invention
En
1878 : Le public français peut découvrir pour la première fois le
téléphone lors de l'Exposition universelle de Paris au deuxième semestre.
Certains pensent alors que le téléphone va rester un jouet, un amusement
scientifique et rien de plus. D'autres reconnaissent que le téléphone n'est pas
encore au point mais qu'il pourrait devenir un merveilleux outil.
L'histoire des téléphones en France suit une évolution de loin moins rapide qu'outre atlantique : le gouvernement s'appuie sur son réseau très bien implanté de télégraphie optique, négligeant ces nouveaux venus que sont le téléphone et le télégraphe électrique de Samuel Morse. La France accumule un retard important jusqu'aux années 70, époque de la grande démocratisation du téléphone. Ce retard explique la relative rareté des téléphones anciens en France, contrairement aux Etats Unis où acheter un modèle 1910 est presque aussi facile que de trouver un big mac.
Cette réticence de l'état français n'empêche pas les inventeurs nationaux de se livrer à toute sorte d'améliorations du système. On remarque les travaux d'Ader, l'aviateur, pour son microphone à charbon, d'Arsonval, pour son récepteur électromagnétique plus sensible que les modèles traditionnels. Malgré ces quelques exceptions, la technologie est en retard et l'idée du téléphone "automatique" est une invention américaine de la fin du XIXeme siècle. Elle ne traverse l'atlantique qu'en 1912. La France l'expérimente un an plus tard à l'échelle d'une ville. C'est pour cette raison qu'on ne trouve pas de téléphones à cadran français avant 1913.
En attendant l'installation de l'automatique sur l'ensemble du territoire (qui n'est effective qu'à la fin des années 1970...), les centraux téléphoniques hébergent un personnel nombreux et qualifié. Les plus célèbres figures de ce microcosme sont les demoiselles du téléphone, ainsi appelées parce que cette catégorie de personnel était recrutée exclusivement parmi des jeunes filles célibataires, dont l'éducation et la morale sont irréprochables. Elles perdaient généralement leur emploi lorsqu'elles se mariaient... Ces demoiselles sont aussi des cibles parfaites pour les clients mécontents du service. On leur reproche leur mauvaise humeur, la lenteur de l'établissement des communications,... Dans le contexte du début du siècle, les abonnés sont surtout des gens fortunés qui ne supportent pas que le "petit personnel" ai autant d'influence sur leur affaires. Pourtant, des concours d'efficacité sont organisés pour améliorer la qualité du service : on met en compétition des opératrices pour assurer le maximum de connexions à l'heure. Les records sont de l'ordre de 400 établissement de connexion / heure, qui correspond à une communication toute les dix secondes...
La fin du téléphone manuel
Elle intervient à la fin des années 1970. La France décide au début 1970 d'étendre les capacités de son réseau
Les premières applications du téléphone sont vouées aux communications essentiellement locales, ou dans un groupe restreint d'utilisateurs. Un opérateur, ce sont alors des hommes, établit les connexions manuellement entre les divers abonnés. Et comme ceux-ci ne sont pas nombreux, il les connaît tous. Lorsque l'état décide d'implanter les premiers réseaux à vocation "grand public", il devient nécessaire de codifier les utilisateurs, c'est à dire de leur attribuer une "adresse" téléphonique. La plus simple codification est de donner un numéro par l'ordre chronologique de demande d'abonnement. Et c'est la méthode qui sera adoptée. En outre, comme le nombre d'abonnés croit, on installe de nouveaux centraux. Les abonnés sont alors reconnus par un numéro au sein d'un central. Par exemple, si M. Dupont est le 273 ième abonné du central Opéra à Paris, on le joint en demandant " Opéra 273 ".
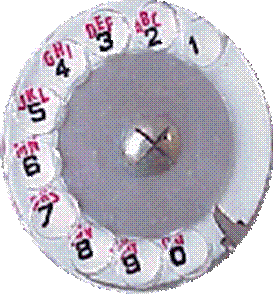
L'automatique arrive en France en 1912. Le problème est alors d'établir une transition entre l'existant et le futur : comment conserver un codage qui fait appel à des chiffres et des lettres, en ayant à sa disposition un cadran qui ne connaît que 10 combinaisons ?
La solution adoptée est d'attribuer à ces dix combinaisons les dix chiffres, et les 26 lettres par recouvrement. Ainsi, la deuxième position du cadran correspond au chiffre 2 et aux lettres A-B-C, la troisième au chiffre 3 et aux lettres D-E-F, et ainsi de suite. Les lettres O et Q sont associés au chiffre 0 en raison de leur ressemblance. Désormais, pour joindre M. Dupont, on prend les 3 premières lettres de son central de rattachement (Opéra, O-P-E) auxquelles on ajoute son numéro (273). Et sa nouvelle adresse d'abonné devient O-P-E-2-7-3, c'est à dire 073-273.
III) Le phénomène « portable » !
Le téléphone mobile est l'un des objets techniques qui se sont le plus largement et le plus rapidement répandus dans la vie quotidienne. Il est à la fois vecteur et révélateur de mutations des comportements en société, des modifications des frontières entre vie publique et vie privée, et des bouleversements du rapport au temps et à l'espace.
L'extraordinaire succès du téléphone mobile en fait tout d'abord un secteur économique à très forte croissance, porté par l'ouverture des réseaux à la concurrence et la très forte sollicitation du public par les opérateurs via un discours qui s'appuie sur l'idée d'appartenance à une communauté caractérisée par la modernité, la liberté et l'efficacité.
Dans les sociétés contemporaines, la sphère sociale, creuset de l'identité individuelle, se parcellise : dans ce contexte, le portable accompagne et permet de nouveaux modes de gestion de la vie quotidienne au point que ses usages nourrissent un nouveau champ d'étude, une véritable sociologie du téléphone mobile qui s'intéresse en particulier à la place singulière de la mobilité et des organisations du temps dans les comportements.
Malgré l'accueil massivement favorable à cette nouvelle technologie, des inquiétudes s'expriment, cas exemplaire de la crise de confiance dans l'action publique, la science et la technique, en matière d'activités à risque en ce qui concerne la santé mais aussi la protection des données personnelles.
Plus largement, le téléphone mobile interroge sur les enjeux politiques et sociaux des technologies de l'information.
IV) Le portable peut faire mal !
 De
nombreuses études ont été menées par des spécialistes pour déterminer les
effets nocifs du portable sur notre organisme. Le portable est accusé de
maux aussi divers que migraines, trous de mémoire, tumeurs cérébrales, etc.
Jusqu'à ce jour, aucune étude n'a pu prouver de tels effets. Mais étant donné
les doutes qui subsistent quant aux dangers liés à l'utilisation continue et
prolongée de cet appareil, les scientifiques préconisent de limiter l'usage du
portable en attendant d'en savoir plus.
De
nombreuses études ont été menées par des spécialistes pour déterminer les
effets nocifs du portable sur notre organisme. Le portable est accusé de
maux aussi divers que migraines, trous de mémoire, tumeurs cérébrales, etc.
Jusqu'à ce jour, aucune étude n'a pu prouver de tels effets. Mais étant donné
les doutes qui subsistent quant aux dangers liés à l'utilisation continue et
prolongée de cet appareil, les scientifiques préconisent de limiter l'usage du
portable en attendant d'en savoir plus.
Par ailleurs, des troubles de santé dus au stress ont été constatés chez des personnes résidant près d'antennes - relais. La peur des ondes émises par ces antennes en serait la cause. Le portable pourrait aussi être à l'origine de maladies musculaires lors d'usage abusif de textos.