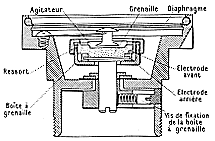
L'évolution technique du téléphone
Depuis son invention en 1876 jusqu’aux années 1970, les constituants d’un téléphone n’ont pratiquement pas évolué. En effet, c’est à cette période qu’apparaisse, les téléphones intégrant la technologie numérique.
I) Le téléphone de 1876 à 1970
A) Les composants d’un téléphone
Le modèle de Alexander Graham Bell était constitué d’un unique transmetteur / récepteur connecté à un appareil identique par deux fils en série avec une batterie.
Pour améliorer la sensibilité et donc la distance séparant deux correspondants, les fonctions microphone et écouteur furent rapidement dissociées. Le combiné est introduit vers 1892 par la société L.M. Ericsson.
La communication s’effectuant sur deux fils, il devient rapidement nécessaire d’améliorer encore le système : on insère une « bobine d’induction » pour amplifier le signal microphonique et réduire le niveau du micro en « local ».
Enfin, un dispositif de signalisation viendra compléter l’ensemble : une magnéto (un générateur de courant alternatif) et une sonnerie sont ajoutées. Le cadran, imposé par l’ « automatique » dont l’invention remonte à 1889, fait son apparition en France en 1913. Le premier réseau automatique public français est installé en 1925.
Les éléments sont alors les suivants :
· Les organes de conversation : microphone, écouteur, bobine d’induction.
· Les organes d’appel (ou de signalisation) : magnéto ou cadran, condensateur et sonnerie, bouton.
On retrouve cette configuration jusqu’au modèle le plus commun en France, le « S63 ».
1) Les organes de conversation
Le rôle du microphone est de traduire des variations de pression créées par la parole en variations de courant. Ce courant est alors transmis par câble électrique jusqu’au récepteur. Le microphone a fait l’objet de nombreuses améliorations. Electromagnétique à ses débuts, il devient électrochimique (une sorte de condensateur dont les armatures étaient mises en mouvement par les variations de la pression de l’air).
Enfin, le microphone proposé par Ader utilise un principe original : des tiges de charbon reposant les unes contre les autres sont agitées par une plaque de bois devant laquelle on doit parler. Son avantage est d’être plus sensible que ses concurrents, et surtout moins coûteux. Il doit cependant être réglé souvent pour conserver ses propriétés. Electriquement parlant, c’est une sorte de résistance variant au rythme de la pression acoustique. Ce principe sera par la suite nettement amélioré : les tiges sont remplacées par de la grenaille de charbon dans laquelle on plonge un agitateur.
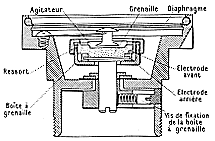
Microphone à charbon type PTT24
Dans La Physique Populaire de 1896, on peut lire l’explication suivante : « Les particules de charbon provoquent des milliers d’étincelles qui sont à l’origine de la modulation du courant [...] ». Ce même ouvrage admet que toutes les tentatives d’explication du phénomène microphone sont loin d’être vérifiées. L’expérimentation règne en maître dans les sciences naissantes.
b) Le récepteur
Le composant électrique qui a subit le moins de transformations technologiques est sans doute l’écouteur, ou récepteur.
Son principe est dit électromagnétique : une bobine placée autour d’un aimant permanent est excitée par le courant microphonique du correspondant. Une membrane en acier est attirée ou repoussée par le champ magnétique ainsi produit, transformant le courant en ondes sonores.
Les seules améliorations de ce procédé furent l’utilisation d’aimants plus puissants et une meilleure étanchéité de la chambre de compression (le volume d’air mis en surpression / dépression par la membrane).
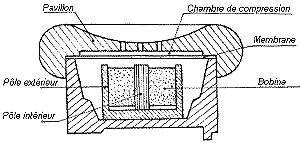
Capsule PTT24.
c) La bobine d’induction
Son rôle est double : elle amplifie en tension le signal du microphone, et elle joue le rôle d’anti-local.
La tension microphonique est si faible que sa transmission sur des lignes téléphoniques de plusieurs kilomètres serait impossible. La bobine d’induction se comporte comme un transformateur : le micro est branché au primaire, la ligne au secondaire de telle sorte que le signal est élevé à des niveaux plus importants.
La fonction d’anti-local est plus subtile : Dans les premiers modèles, microphone et écouteurs étaient connectés en série. L’inconvénient majeur était que l’on entendait sa propre voix bien plus fort que celle du correspondant, ce qui rendait les conversations particulièrement difficiles. On a alors imaginé d’atténuer le signal local (le microphone) afin d’équilibrer la sensation de volume. Mais attention, le niveau local n’est pas totalement absent : trop l’atténuer entraînait une autre gêne : celle de ne s’entendre parler que d’une seule oreille. Après bien des essais, il a été convenu de renvoyer une fraction donnée du signal local.
Ce niveau de réinjection locale de la voix est aujourd’hui défini et normalisé. Mais sa valeur dépend des pays : Aux états unis, il est plus élevé qu’en Europe. Les Américains seraient-ils légèrement sourds ?
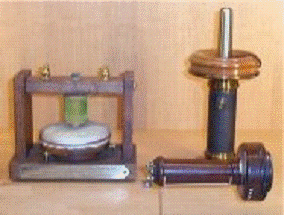
Bobine d’induction type 1910
a) La magnéto
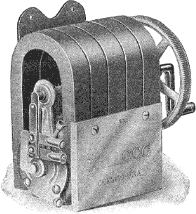 Elle
est souvent considérée comme le symbole des téléphones anciens. Pourtant, bien
que celle-ci apparaisse dès 1880, on ne l’installe de façon systématique en
France qu’à partir de 1910 avec le poste Marty.
Elle
est souvent considérée comme le symbole des téléphones anciens. Pourtant, bien
que celle-ci apparaisse dès 1880, on ne l’installe de façon systématique en
France qu’à partir de 1910 avec le poste Marty.
Son rôle est de générer un courant alternatif qui, transmis sur la ligne, provoque la chute du volet d’appel sur le tableau de l’opératrice.
La magnéto est constituée d’un bobinage tournant dans une « cage » comportant plusieurs aimants permanents. C’est exactement l’inverse d’un moteur.
Les abonnés ont longtemps cru que tourner la manivelle plusieurs fois agacerait les demoiselles, espérant ainsi être mieux servi. En réalité, lorsque le petit volet de l’abonné était tombé, il ne se passait plus rien, si ce n’est un imperceptible bourdonnement.
b) La sonnerie
La version pour réseaux à batterie centrale est plus simple : le courant d’appel est alternatif. La bobine attire ou non le balancier, en fonction de la valeur instantanée de la tension. Le résultat audible est identique, mais l’ensemble gagne en fiabilité puisque le contact a disparu.
Initialement installée à côté du poste, elle a peu a peu intégré le téléphone sous des formes diverses : quelques rares U43 possèdent un ronfleur, dont la seule différence avec la sonnerie est l’absence de cloche. Son intégration définitive arrive avec le S63, dont les dernières versions possèdent même, comble de luxe, un réglage de volume.
Dans le premier cas, une pile branchée chez l’abonné assure l’alimentation du microphone. L’appel de l’opératrice s’effectue en tournant la magnéto, ou en appuyant sur le « bouton d’appel » (dans ce cas, une deuxième pile est nécessaire). Ces réseaux sont manuels (pas de cadran d’appel).
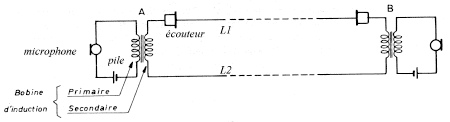
Principe des postes à batterie locale
En batterie centrale, le courant microphonique est fournit par le réseau lorsque l’abonné décroche le combiné. La pile locale disparaît. La signalisation (la détection de l’appel par l’opératrice) peut être soit manuelle (magnéto ou bouton d’appel) ou automatique : le fait de décrocher le combiné signale le début d’un appel.
Dans les réseaux ou l’alimentation du micro et la signalisation sont assurés par le central, on parle de réseau à Batterie Centrale Intégrale (BCI).
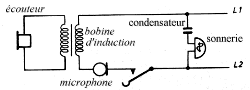
Principe des postes à batterie centrale
Les réseaux automatiques sont de type batterie centrale. L’opératrice est remplacée par un auto commutateur dont la fonction est de traduire les impulsions du cadran d’appel en numéro, puis de mettre en relation les deux abonnés.
Le réseau national impose un cahier des charges pour les téléphones devant s’y connecter.
C’est ainsi qu’apparaît le Marty 1910. Cette uniformité n’existe pas dans les réseaux à usages privés. Depuis les simples appareils que l’on connecte sur « l’installation de sonnerie existante » jusqu’au système semi-automatique à batterie locale, tout ce qui est possible d’imaginer existe. Il n’y a aucune norme, et seule la volonté de réduire le coût du téléphone guide les fabricants : système d’appel simplifié (bouton et sonnette branché sur un fil dédié), pas de bobine d’induction (les distances sont courtes) et batterie unique.
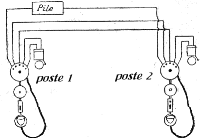
Câblage en interphone avec appel.
Les plus simple sont à montage de type « interphone ». Dans une installation de trois à une dizaine de postes, seul le poste maître peut appeler les autres.
Enfin, il existe des petits tableaux commutateur nécessitant une opératrice. Celle-ci peut mettre en relation chacun des postes, et éventuellement le réseau public.
A partir de 1970, avec l’apparition de la technologie numérique, les téléphones ont pu évoluer. Ainsi le traditionnel cadran rotatif de numérotation laisse au fur et à mesure place au clavier à numérotation à touches. De plus le passage progressif aux techniques numériques fera ensuite émerger les réseaux actuels de radiocommunication cellulaire.
II) Du Fil au sans fil
Comme dit précédemment, le premier téléphone a fonctionné aux Etats-Unis en 1876. C’est une dizaine d’années plus tard, en 1885, que le téléphone sans fil fait son apparition, sous la forme d’un radiophone. Marconi mit au point, quelques années plus tard, en 1896, la télégraphie sans fil et la radio. Le 18 janvier 1903, il envoie un message d’un côté à l’autre de l’Atlantique, ce qui est une grande première pour son époque.
Ce n’est qu’en 1979, en Suède, que le premier téléphone portable voit le jour. Depuis son invention, le téléphone portable n’a pas cessé d’évoluer.
Globalement, les téléphones portables fonctionnent comme des émetteurs-récepteurs de radio : le message sonore émis par un mobile est transformé en signal électrique et véhiculé par une onde porteuse qui voyage dans l’atmosphère sous forme d’ondes électromagnétiques jusqu’au téléphone destinataire du message. Cette technologie trouve donc ses fondements dans la science physique et, notamment, l’électromagnétisme.
Depuis son apparition, le téléphone portable, n’a pas cessé d’évoluer, intégrant ainsi plus en plus de fonction tout en se miniaturisant de plus en plus. Parmi ces nombreuses fonctions, les plus communes aujourd’hui sont :
- l’écran couleur
- la possibilité d’écrire des messages sous forme de SMS (Short Messaging Service) et MMS (Multimedia Message Service)
- l’appareil photo numérique
- la possibilité d’enregistrer des vidéos de quelques minutes
- les jeux
- la lecture de MP3
- la radio
- la navigation sur Internet
En ce qui concerne la navigation sur Internet le portable fut tout d’abord doté de la technologie Wap. Pas assez performant, le Wap est concurrencé par l’i-Mode, beaucoup plus riche en applications. Mais c’est finalement l’UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) qui les détrônera tous deux. C’est la téléphonie mobile de troisième génération ou 3G.
La première génération étant la norme analogique déployée en France par France Telecom dans les années 80.
La deuxième génération étant la norme Global system for Mobile Communication (GSM), norme numérique de 2e génération fonctionnant sur la fréquence de 900 Mhz. Une variante appelée Digital System for Communication (DCS) utilise la gamme des 1800 Mhz. Cette norme est principalement utilisée en Europe, Asie, Afrique et au Moyen-Orient.
Cette nouvelle norme cellulaire de troisième génération autorisera l’acheminement d’images, de la vidéo et de grandes quantités de données sur les téléphones portables.
Atteignant 2 Mb/s dans certaines conditions, les vitesses de transmission offertes par les réseaux UMTS seront nettement plus élevées que celles des réseaux GSM qui plafonnent vers 150 kb/s (avec GPRS).
Il est non seulement possible de surfer sur Internet grâce à son portable, mais il est aussi possible d’écouter de la musique. Vivendi Universal propose le service Universal Mobile Music qui permet d’écouter tous les CD sur son portable avant leur sortie.
Les principales caractéristiques de l’UMTS sont :
- de nouvelles bandes de fréquences : 1900-1920 MHz, 1920-1980 MHz, 2010-2025 MHz, 2110-2170 MHz.
- la compatibilité avec les systèmes de 2ème génération.
- un support accru pour le multimédia.
- des services de visiophonie mobile.
- un débit optimal théorique de 2 Mbits/s contre 171 kbits/s pour le GSM en mode paquet.
- de nouveaux terminaux.
Autre fonctionnalité qui s’ajoute maintenant au téléphone cellulaire, la détection de gaz et d’odeurs. Ce détecteur est une puce électronique qui a été développée par Siemens Mobile, société allemande de télécommunications. Une des dernières nouveautés du téléphone portable est la fonction jetable. De la taille d’une carte de crédit, ce téléphone aura une durée de vie très limitée.
En dépit de toutes ses qualités technologiques, le téléphone portable peut subir des attaques. Celles-ci peuvent être d’ordre informatique sous la forme de virus téléphoniques, ou bien d’ordre physique sous la forme de vols. Des dispositifs techniques ont été mis au point par la police et les opérateurs de téléphonie mobile pour rendre inutilisables les mobiles volés. Pour agir préventivement et dissuader les voleurs, un inventeur sud-africain a eu l’idée d’incruster, en fond d’écran, la photographie et les coordonnées du propriétaire afin de rendre la revente du mobile impossible. Le téléphone portable a beau être très sophistiqué, son fonctionnement nécessite la présence d’antennes relais pour acheminer les communications. Certaines régions montagneuses sont privées de cette technologie, faute d’antennes dans ces contrées.