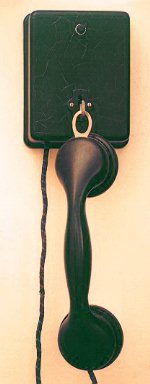Evolution du design et des matériaux
I)
1876-1920 : Les débuts
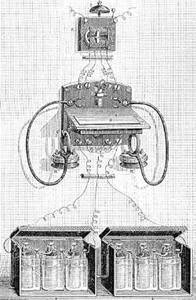 Dans les toutes premières installations (1876), le
téléphone n'était qu'une petite partie du matériel nécessaire. Deux piles,
servant au microphone et au courant d'appel, devaient être connectées.
Celles-ci étaient constituées d'une bouteille de verre remplie d'électrolyte,
et d'électrodes (Zinc et Cuivre). L'entretien de ces piles fût un problème
pendant longtemps (difficulté de savoir lorsqu'elles étaient usées,
remplacement des électrodes délicat).
Dans les toutes premières installations (1876), le
téléphone n'était qu'une petite partie du matériel nécessaire. Deux piles,
servant au microphone et au courant d'appel, devaient être connectées.
Celles-ci étaient constituées d'une bouteille de verre remplie d'électrolyte,
et d'électrodes (Zinc et Cuivre). L'entretien de ces piles fût un problème
pendant longtemps (difficulté de savoir lorsqu'elles étaient usées,
remplacement des électrodes délicat).
La fonctionnalité était largement privilégiée par rapport à l’esthétique :
De nombreux fils sont en apparences et les matériaux employés sont
principalement le bois, le cuivre et le laiton.
 Avant
l'invention du combiné, vers 1889, le microphone est solidaire du boîtier. Il
est généralement situé derrière une planchette de pin dont le rôle est de
capter les vibrations sonores de la voix. Les deux écouteurs placés sur le
côté, qui portent alors le nom de téléphones, permettent de s'isoler totalement
des bruits extérieurs. Cette dernière précaution est indispensable : le niveau
de parole reçu est très faible. De plus les écouteurs sont munis de poignées
ergonomiques. Le câblage a également été dissimulé sous le socle de bois.
Avant
l'invention du combiné, vers 1889, le microphone est solidaire du boîtier. Il
est généralement situé derrière une planchette de pin dont le rôle est de
capter les vibrations sonores de la voix. Les deux écouteurs placés sur le
côté, qui portent alors le nom de téléphones, permettent de s'isoler totalement
des bruits extérieurs. Cette dernière précaution est indispensable : le niveau
de parole reçu est très faible. De plus les écouteurs sont munis de poignées
ergonomiques. Le câblage a également été dissimulé sous le socle de bois.
 Bien que le bois soit encore largement utilisé dans la
réalisation des postes, un autre matériau vient libérer les créateurs de
téléphones, l'ivorine. Composée de gutta percha (un isolant alors très
utilisé dans la fabrication des câbles transocéaniques), de poudre de marbre et
parfois de ciment, l'ivorine permet le moulage à chaud. Ce poste de 1908 est un
exemple de l'association du bois pour la réalisation de la platine, et de
l'ivorine pour le boîtier, avec bouton d'appel central en ivoire. Le microphone
est combiné à l’un des deux écouteurs : on appelle cet ensemble un cornet.
Bien que le bois soit encore largement utilisé dans la
réalisation des postes, un autre matériau vient libérer les créateurs de
téléphones, l'ivorine. Composée de gutta percha (un isolant alors très
utilisé dans la fabrication des câbles transocéaniques), de poudre de marbre et
parfois de ciment, l'ivorine permet le moulage à chaud. Ce poste de 1908 est un
exemple de l'association du bois pour la réalisation de la platine, et de
l'ivorine pour le boîtier, avec bouton d'appel central en ivoire. Le microphone
est combiné à l’un des deux écouteurs : on appelle cet ensemble un cornet.
 Dans les années vingt, la mode inspire aux fabricants
les combinés "hygiéniques". On reproche en effet aux combinés
traditionnels d'être un vecteur de contagion des maladies. Ainsi, la forme de
cornet permet à l'usager de nettoyer le conduit du micro à l'aide d'un simple
chiffon. Le bois et les matériaux nobles
disparaissent à l'avantage de matériaux plus fonctionnels comme l’acier.
Dans les années vingt, la mode inspire aux fabricants
les combinés "hygiéniques". On reproche en effet aux combinés
traditionnels d'être un vecteur de contagion des maladies. Ainsi, la forme de
cornet permet à l'usager de nettoyer le conduit du micro à l'aide d'un simple
chiffon. Le bois et les matériaux nobles
disparaissent à l'avantage de matériaux plus fonctionnels comme l’acier.
Ces combinés s'appellent monophone
ou diaphone selon les fabricants. Le microphone et l'écouteur sont
installés dans la partie supérieure, le cornet jouant le rôle de conduit
acoustique.
S'agissant d'une mode, ces téléphones sont généralement vendus plus cher. Quand
aux propriétés hygiéniques, elles ne sont pas vraiment démontrées...
II)
1900-1930 : Les téléphones privées
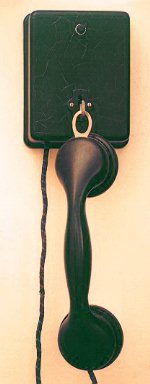
 Alors que le réseau public connaît un développement
très lent, les constructeurs de matériel téléphonique proposent des postes pour
installations privées. Ils sont utilisés généralement en " point à point
", c'est à dire pour relier une pièce de la maison à une autre. Malgré
leurs performances généralement médiocres, ils connaissent un succès certain au
près du public, friand de ce nouveau mode de communication.
Alors que le réseau public connaît un développement
très lent, les constructeurs de matériel téléphonique proposent des postes pour
installations privées. Ils sont utilisés généralement en " point à point
", c'est à dire pour relier une pièce de la maison à une autre. Malgré
leurs performances généralement médiocres, ils connaissent un succès certain au
près du public, friand de ce nouveau mode de communication.
Les
téléphones des installations privées, c'est à dire non reliées au
"réseau" sont beaucoup plus simples de conception : une fixation
murale et un combiné suffisent. Il n'y a pas obligatoirement de sonnerie, et
l'appel se fait en décrochant le combiné.
III)
1930-1950 : Vers la démocratisation

Le modèle ayant le plus contribué à la démocratisation
du téléphone en France est sans aucun doute le poste Universel 1943, ou
U43.
Son cahier des charges est ambitieux :
Ø il doit être universel, c'est à dire compatible des
types de réseaux les plus courants (réseaux automatiques ou manuels à batterie
centrale).
Ø son coût de fabrication doit être faible afin de
répondre à une forte demande.
Ø en raison de la pénurie de métaux en période de
guerre, il doit être conçu à base de matériaux plus disponibles.
Pour répondre à ces derniers critères, on fait appel à la Bakélite, permettant les
techniques du moulage.
IV) 1950-1965 : Les nouvelles formes

Cette génération de
téléphones marquent aussi l'entrée du plastique dans la
réalisation de la coque, jusque là presque uniquement réalisée en Bakélite,
bois ou métal. Ils font généralement partie d'installations privées d'hôtels et
d'entreprises.

Alors que la forme des premiers téléphones est
largement imposée par la fonction et la matière, l'entrée du plastique permet
des fantaisies, telle ce curieux poste CIT de 1965.
V)
1963-1985 : La fin de l’électromécanique
 Le poste le plus largement fabriqué reste le S63. Il
tient son nom de l'abréviation SO. CO. TEL (Société des Constructeurs de
Téléphone) et de sa date de conception, 1963. C'est un poste de fabrication moderne :
châssis et coque en plastique injecté, circuit imprimé recevant tous les
composants électronique, sonnerie intégrée à volume réglable. La première
version est fabriquée en couleur grise.
Le poste le plus largement fabriqué reste le S63. Il
tient son nom de l'abréviation SO. CO. TEL (Société des Constructeurs de
Téléphone) et de sa date de conception, 1963. C'est un poste de fabrication moderne :
châssis et coque en plastique injecté, circuit imprimé recevant tous les
composants électronique, sonnerie intégrée à volume réglable. La première
version est fabriquée en couleur grise.
Il est par la suite décliné en bleu, marron, rouge et
blanc. On lui adjoint dès 1981 un clavier à numérotation décimale, puis à
fréquence vocale, alors utilisée sur les premiers centraux électroniques. Il
possède les dernières innovations techniques : régulation automatique du
courant de ligne, anti-surtension pour l'écouteur, possibilité de connecter
plusieurs postes en parallèle. C'est aussi avec le S63 qu’apparaît la prise
gigogne.
 Le poste Télic 1975, ou T75, est le premier poste
téléphonique "électronique" français. Il est conçu et fabriqué à
Strasbourg, dans l'une des unités qui deviendra plus tard Alcatel. Ses
innovations sont un design particulièrement proche des tendances de son époque
(formes arrondies, couleur orange), la numérotation par clavier
Le poste Télic 1975, ou T75, est le premier poste
téléphonique "électronique" français. Il est conçu et fabriqué à
Strasbourg, dans l'une des unités qui deviendra plus tard Alcatel. Ses
innovations sont un design particulièrement proche des tendances de son époque
(formes arrondies, couleur orange), la numérotation par clavier
électronique, et la possibilité d'écoute amplifiée. Etant
un modèle haut de gamme, sa diffusion sera relativement restreinte en raison de
son coût. Le design de ce poste servira plus tard de base aux terminaux
téléphoniques du système de réseau pour entreprise type T16.

A partir de la fin des années 80, les téléphones se
diversifient par leur forme et leur couleur mais sans nouvelle révolution. Les
matériaux utilisés sont essentiellement des plastiques (par exemple l’ABS) qui
permet d’obtenir des états de surfaces très variés.
VI)
1980-2005 : Le téléphone portable
 Sous le nom de radiotéléphonie cellulaire, une
révolution dans le domaine du téléphone s’est accomplie au cours des années 80.
Elle a démarré en Suède, en 1979, sous l’impulsion de la société Ericsson.
Sous le nom de radiotéléphonie cellulaire, une
révolution dans le domaine du téléphone s’est accomplie au cours des années 80.
Elle a démarré en Suède, en 1979, sous l’impulsion de la société Ericsson.
En France, le téléphone de voiture a commencé
à s’étendre à partir de 1985, avec Radiocom 2000, de Matra. Le téléphone
cellulaire utilise des ondes hertziennes pour acheminer les communications. Le
terme « cellulaire » vient du découpage du territoire en « cellules » de
petites dimensions, desservies chacune par un émetteur. L’ensemble est contrôlé
par un système informatique.

De nos jours le téléphone cellulaire plus communément
appelé « portable » est devenu un phénomène de société. La couleur et
les formes évoluent suivant les modes. Il sert aussi bien de téléphone que
d’appareil photo ou même de caméscope. La seule contrainte à respecter dans
l’optique de miniaturisation et la distance qui sépare l’oreille et la bouche
humaine.



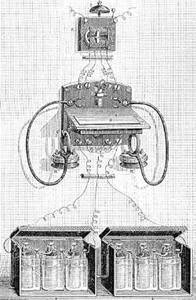 Dans les toutes premières installations (1876), le
téléphone n'était qu'une petite partie du matériel nécessaire. Deux piles,
servant au microphone et au courant d'appel, devaient être connectées.
Celles-ci étaient constituées d'une bouteille de verre remplie d'électrolyte,
et d'électrodes (Zinc et Cuivre). L'entretien de ces piles fût un problème
pendant longtemps (difficulté de savoir lorsqu'elles étaient usées,
remplacement des électrodes délicat).
Dans les toutes premières installations (1876), le
téléphone n'était qu'une petite partie du matériel nécessaire. Deux piles,
servant au microphone et au courant d'appel, devaient être connectées.
Celles-ci étaient constituées d'une bouteille de verre remplie d'électrolyte,
et d'électrodes (Zinc et Cuivre). L'entretien de ces piles fût un problème
pendant longtemps (difficulté de savoir lorsqu'elles étaient usées,
remplacement des électrodes délicat).